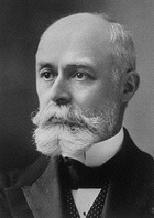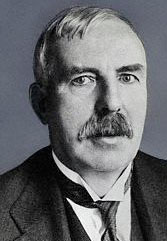Historique complet sur la découverte
de la Radioactivité et sur les découvertes qui ont suivi
C'est
le 28 Décembre 1895 qu'eut lieu la découverte des rayons X par Willhelm Conrad
Roentgen, un physicien allemand.
En 1896, Henri Becquerel,
un physicien français (voir photo ci-dessous ; 1852-1908), découvre la radioactivité
naturelle de l’Uranium ; et ce par accident au cours de ces recherches sur la
fluorescence des sels d’Uranium. Ces recherches lui furent suggérées par Henri
Pointcarré lors d’une représentation quant à l’utilisation de la radiographie
le 20 Janvier à l’Académie des Science.
Henri Becquerel avait donc
cherché à savoir si l’émission des rayons X était liée à la phosphorescence.
La découverte de la radioactivité naturelle fut donc, pour lui,
tout à fait fortuite. En effet, c’est par un jour de mauvais temps qu’il rangea
dans un tiroir un sel phosphorescent d’Uranium (car il ne pouvait pas l’exposer
au soleil) ainsi qu’une plaque photographique vierge
enveloppée dans du papier noir (donc à l’abri de la lumière). C’est quand il
retira du tiroir ces deux matériaux qu’il découvrit que la plaque photographique
avait été impressionnée. Il en conclut donc que le sel d’Uranium avait émis
spontanément un rayon pénétrant qui était capable d’impressionner la plaque
photographique. Suite à cette découverte, il étudia différents sels d’Uranium
(phosphorescents ou non). C'est ainsi qu'il déduisit que ce rayonnement
était émis par l’Uranium. Il nomma donc les rayons émis « rayons uraniques
». De plus, il constata que ces rayons étaient également capables d’électriser
l’air. En réalité, les rayons découverts par Henri Becquerel
correspondent aux rayons Bêta et Gamma que nous définirons par
la suite.
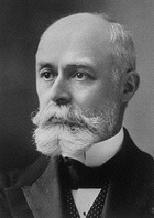
En Novembre 1897, Marie Sklodowska-Curie
(voir photo ci- dessous ; 1867- 1934 : morte suite à ses multiples recherches
sur la radioactivité), physicienne française d‘origine polonaise, tente de rechercher
ces « rayons uraniques » dans différents éléments, composés et minéraux. Elle
a appris qu’ils étaient capables d’électriser l’air qui les entoure. Elle utilisa
donc cette propriété, et, à l’aide d'un électromètre
à quartz piézoélectrique (capable de mesurer de très faibles valeurs d’intensité
électrique), elle en déduisit que la radioactivité était attachée
à l’atome et non à la molécule. Elle était ainsi persuadée que c’était
à l’intérieur même du noyau que quelque chose se modifiait.
En
1898, Pierre et Marie Curie découvrent du Polonium et du Radium,
éléments jusqu’alors inconnus, qui sont présents en
faible quantité dans le Pechblende (minéral de l’uranium). Dans la même année,
Marie Curie parvient à isoler le Radium qui
s'avère être un million de fois plus radioactif que l'Uranium (elle
trouvera en 1902 la masse volumique de cet élément qui est de
225g/mol)

En
1900, Paul Villard reconnaît les rayons Gamma comme des photons, particules
possédant une grande énergie et étant de même nature que les rayons X.
De
1901 à 1903, Ernest Rutherford (voir photo ci-dessous ; 1871- 1937) et
son élève Frédéric Soddy (un jeune chimiste) mettent en évidence que
chaque élément a sa propre période et que cette période est caractéristique
d'une loi de la décroissance qui gouverne la radioactivité (loi que nous verrons
par la suite). Ils prouvent également que la radioactivité s’accompagne de la
transmutation d’un élément en un autre.
En 1902, Ernest Rutherford
montre que les rayons Alpha et les rayons Bêta (que nous définirons par
la suite) entraînent
la transmutation des atomes (transformation de certains corps en corps différents).
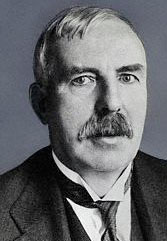
Le
10 décembre 1903 Pierre et Marie Curie ainsi que Becquerel obtiennent le prix
Nobel de physique pour la découverte (par Becquerel) et l’étude (de Curie) de
la radioactivité naturelle de l’Uranium.
En
1906, Jean Perrin prouve définitivement l’existence de l’atome, qui avait
été jusque là controversée.
En
1908, Ernest Rutherford obtient le prix Nobel
de chimie pour la découverte des rayons Alpha et Bêta. Il prouve également que
les atomes d’Hélium sont doublement chargés ou ionisés; et il découvre la même
année que la radioactivité s’accompagne de la désintégration des éléments.
En
1911, Marie curie obtient le prix Nobel de chimie
pour ses travaux sur le Radium.
La même année,
Ernest Rutherford met en évidence l’existence d’un noyau au cœur des atomes
; et ce en bombardant, avec deux de ses élèves (Ernest Marsden et Hans Geiger),
une mince feuille d’or avec des particules alpha émises par le Radium.
En
1913, Fréderick Soddy (voir photo dans "galerie photo") introduit
le concept de l’isotopie (que nous verrons là encore par la suite). Il
recevra le prix nobel de chimie en 1921.
En
1919, Ernest Rutherford réalise la première transmutation atomique ; c'est à
dire la première "réaction nucléaire" (il bombarda de l’azote
avec des particules alpha, ce qui les transforma en oxygène).
En
1930, deux spécialistes allemands du rayonnement cosmiques (W. Bothe et H.
Becker) découvrent les rayons Gamma. Ils ont en effet observé que
des éléments légers, bombardés par des particules alpha, émettaient des rayons
« ultras pénétrant » qu’ils supposaient être des rayons Gamma.
La même année, le physicien américain
Wolfgang Pauli (1900-1958), propose l’existence d’une nouvelle particule
neutre, et ce, dans le but de clarifier, d'une part, la non-conservation de
l’énergie lors de la désintégration et, d'autre part, le problème de la « parité
des noyaux ».
En 1931, Irène (1897-1956 ; scientifique française fille de Marie Curie)
et Frédéric Joliot-Curie (1900-1958), physicien français, découvrent
que les rayons Gamma ont la propriété de mettre en mouvement les noyaux atomiques
; surtout les protons.
En 1932, Ernest Rutherford et Sir John Cockfrot (physiciens anglais)
réussissent la première fission de l’atome.
La même année, James Chadwick
fait la découverte du neutron et confirme l'existence des rayons Gamma.
En
1933, Enrico Fermi, physicien italien (voir photo dans "galerie
photo" ; 1901-1954) propose le nom de « neutrino » à la particule inventée
par Pauli et formule une théorie quantitative des interactions faibles.
En
1934, Frédéric Joliot-Curie (voir photo dans "galerie photo") participe
avec sa femme sur la structure de l‘atome.Tous deux découvrent la radioactivité
artificielle. Ils travaillent également sur la radioactivité naturelle et sur
la transmutation des éléments.
En 1935, ils obtiennent
le prix Nobel de Chimie pour la découverte de la radioactivité artificielle.
En
1938, Otto Hahn, Fritz Strassman et Lise Meitner mettent en évidence
que les noyaux d’Uranium 235, lorsqu’ils sont bombardés par des neutrons, éclatent.
C’est la découverte de la fission nucléaire.
En
Janvier 1939, Frédéric Joliot-Curie prouva que le noyau se fragmentait.
Dans la même année, une équipe
du Collège de France démontre que la fission de l’Uranium peut entraîner une
réaction en chaîne.
Par ailleurs, Enrico Fermi
obtient le prix Nobel de Chimie.
En
1942, la première pile atomique est réalisée par Enrico Fermi.
En
1945, c'est l'explosion des deux premières bombes nucléaires (dont Enrico Fermi
aura participé à la construction) sur Hiroshima et Nagasaki lors de la
seconde guerre mondiale.
En
1951, la première centrale nucléaire à fission (The National Reactor Station)
entre en fonction aux Etats-Unis dans l’Idaho.
En
1955, Murray Gell Mann, physicien américain, établit la notion d’interaction
faible.
En
1956, c'est la mise en évidence du neutrino par Reines et Cowan.
D'autres
découvertes ont bien entendu suivi et d'autres suivront encore...